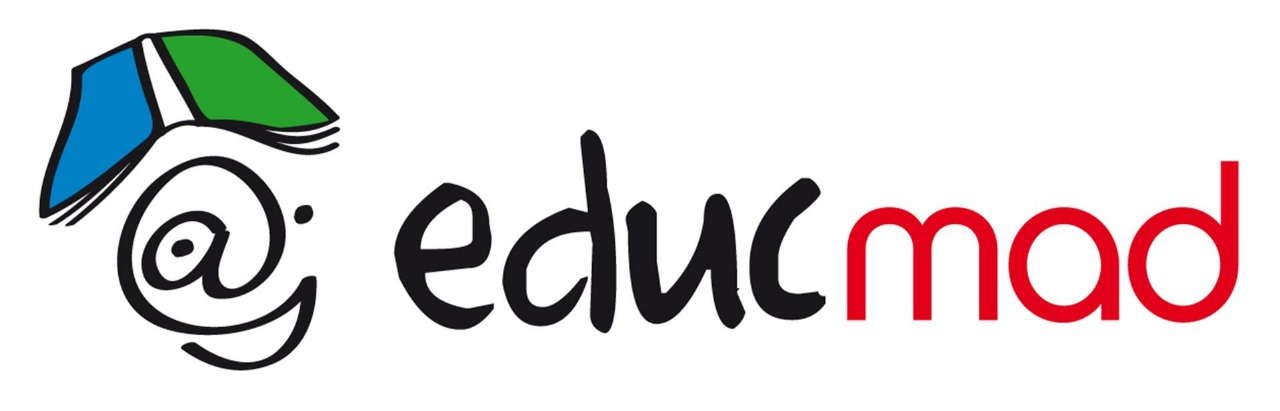Résultats pratiques de la reconnaissance du sol
Résumé de section
Source de document : http://dc313.4shared.com/doc/kxr3vyRa/preview.html
RECONNAISSANCE DES SOLS
G- Résultats pratiques de la reconnaissance du sol
Pour le terrain exploré
La synthèse des résultats obtenus par les diverses reconnaissances permet d’établir la coupe géologique des diverses couches rencontrées avec l’indication des taux de travail admissibles respectifs, et celles des anomalies nécessitant des injections de stabilisation,
Rôle de l’architecte :
- décide des emplacements préférentiels d’implantation des divers bâtiments d’un ensemble selon les charges respectives qu’ils transmettent au sol : tours, groupe scolaire, pavillons, soit en définitive d’élaborer le plan-masse fonctionnel le plus économique parce que conçu selon les possibilités réelles du sous-sol,
- à chaque fondation les dimensions optimales, il assure la stabilité de l’ouvrage, tout en évitant des fondations abusives et coûteuses,
- dans le cas de présence de nappe phréatique, il choisit les liants appropriés capables de résister aux eaux agressives éventuelles et de prévoir l’importance des épuisements nécessaires,
Indications pratiques générales résultant de la mécanique des sols
Pour les sols des fondations, les terrains peuvent être classifiés ainsi :
a) Les remblais
à moins d’être anciens et bien tassés, sont impropres à supporter des constructions lourdes et durables et devront être traversés pour retrouver le bon sol. Dans ce cas les contraintes généralement admises sont :
- remblais non tassés - 0 Mpa ;
- remblais récents, comprimés par couches arrosées - 0,02 à 0,06 Mpa ;
- remblais anciens et consolidés - 0,05 à 0,1 Mpa ;
b) Les terrains compacts incompressibles
Constituent d'excellents supports, lorsqu’il s’agit de roches dures, en masses profondes, compactes et homogènes. Dans ce cas les résistances sont :
- les granits et autres roches ignées - 2,5 à 4 Mpa ;
- les calcaires, grès, schistes - 0,7 à 1,5 Mpa ;
Dans le cas d’importantes fissures, de cavités creusées par l’eau, ou de stratifications peu favorables, il est recommandé de réduire de moitié la contrainte admissible.
c) Les terrains cohérents
Tels que argiles, marnes, sable argileux, plus ou moins compacts, nécessiteront une étude sérieuse car leur portance peut varier considérablement selon la teneur en eau et leur consistance. Dans ce cas on trouve :
- terrain mou, pétrissable à la main - 0,02 à 0,06 Mpa ;
- terrain consistant, difficile à pétrir - 0,08 à 0,15 Mpa ;
- terrain compact qui s’émiette - 0,15 à 0,30 Mpa ;
- terrain dur ou en masse compacte - 0,30 à 0,40 Mpa;
Les terrains compressibles et affouillables
– telles que terre végétale, terres fluentes (vases, limons), tourbe, glaise et marnes très plastiques, constituent de très mauvais terrains qu’il faut traverser en général si l’on veut trouver un bon sol pour des constructions durables. Dans ce cas ils peuvent avoir des contraintes dépassant rarement la valeur de 0,06 Mpa.
Indications à retenir de l’étude des conditions de tassement des sols
1. Dans les terrains argileux cohérents, ce tassement dit de consolidation, résulte de l’expulsion de l’air et de l’eau inclus dans la couche intéressée, et cela sous les charges de l’ouvrage. Le phénomène plus ou moins lent varie avec nombreux paramètres : composition de l’argile, sa compacité, sa plasticité, la forme et les dimensions en plan de la fondation et aussi les caractéristiques des sols sous-jacents et latéraux.
2. Dans les terrains non cohérents (par exemple sable et graviers relativement secs) l’équilibre du sol se produit assez rapidement au fur et à mesure de la construction de l’ouvrage, mais le tassement est fonction de l’épaisseur de la couche et aussi de la forme des dimensions de la fondation.
3. En pratique de faibles tassements, de l’ordre de 5 à 30 mm ne sont pas dangereux lorsqu’ils sont progressifs et réguliers. Le tassement prévu, calculé, ne doit en aucun cas mettre en cause la stabilité de la construction.
Comment se répartissent les pressions dans le sol
La charge appliquée sur le sol d’assise par la fondation crée des contraintes non seulement sur la surface de contact mais aussi à l’intérieur des couches inférieures.
La répartition de ces efforts varie selon le degré de cohésion et d’homogénéité du terrain et aussi selon la forme et les dimensions du massif de fondation.
La répartition des pressions dans un plan horizontal situé à une profondeur (h) de la surface d’assise s'effectue comme sur le schéma :
Dans ce cas la courbe des efforts épouse la forme d’une cloche et, des formules complexes données par Boussinesq et Frölich, permettent de déterminer les contraintes aux différents points du plan considéré.
Dans le plan vertical, Boussinesq a traduit cette répartition des pressions en courbes d’égales pressions délimitant des bulbes de terrain, d’allures très variables selon la forme de la fondation et ses dimensions :