Source de document : www.geotech-fr.org
CARACTÉRISTIQUES ET CLASSIFICATION DES SOLS
Introduction :
En 1947, le Professeur A. Casagrande écrivait (1) que les deux chapitres les plus controversés de l'étude géotechnique des sols étaient :
- la classification des sols - Chapitre le plus confus ;
- la résistance au cisaillement des sols – Chapitre le plus difficile.
Nous nous garderons de prendre position sur le point 2, mais croyons pouvoir dire que le «Chapitre » de la classification des sols reste encore controversé et le restera probablement toujours.
Toutefois, plutôt que de voir chaque ingénieur appeler les sols à «sa manière» et utiliser un système de classification plus ou moins personnel, il apparaît indispensable que nous adoptions un système de classification unique — même imparfait — qui devra être appliqué «servilement et intelligemment».
Le système de classification dont je vais parler semble être le plus complet et le mieux adapté à nos problèmes. Evidemment, il est déjà et sera encore critiqué par certains utilisateurs (ou plutôt par ceux qui ne veulent pas faire « l'effort» de l'utiliser) qui trouvent qu'il s'applique mal ou même pas du tout à « leurs » sols locaux. Nous pensons qu'il faut dire aujourd'hui à ces derniers qu'il sera certainement possible — à l'aide de quelques retouches et modifications à faire après un certain temps d'utilisation — de mieux adapter le système de classification à certains cas particuliers.
QU'EST-CE QU'UNE CLASSIFICATION GEOTECHNIQUE DES SOLS ? QUELLE EST SON UTILITE ?
Une classification géotechnique des sols a pour but de ranger les sols par catégories présentant les mêmes caractéristiques géotechniques ou du moins des caractéristiques géotechniques voisines.
C'est ainsi que les Allemands (2), par exemple, associent directement à la classification une appréciation sur la gélivité. Les Américains (3) vont jusqu'à donner pour chaque type de soi de la classification, une appréciation sur : sa valeur en tant que couche de fondation ou couche de base, sa sensibilité au gel, ses caractéristiques drainantes, ses possibilités de tassement et de gonflement, la fourchette moyenne des densités sèches, C.B.R., modules de réactions atteints sur chantier, etc. Il semble utile de préciser que des formations géologiques identiques peuvent donner des sols très divers du point de vue géotechnique, et inversement, des formations géologiques diverses peuvent donner des sols analogues du point de vue géotechnique.
(*) Unified Soil Classification System (U.S.A.).
(1) American Society of Civil Engineers, juin 1947, page 783.
(2) Cf. document ZTVE-StB 59 ou article de M. Dùcker dans Strasse und Autobahn - N° 1, 1964, page 2.
(3) Cf. tableau II-2, page 66 du « Soils Manual » (The Asphalte Institute) donné « à titre indicatif » dans l'Annexe VI du document - Reconnaissance Géotechnique des Tracés d'Autoroutes
Ceci ne veut pas dire que l'indication de la formation géologique n'intéresse pas le géotechnicien.
Au contraire, elle doit être donnée systématiquement pour :
— d'une part compléter la description du sol (à côté de la désignation locale et d'une désignation géotechnique détaillée dont je dirai quelques mots),
— d'autre part fournir un renseignement directement utilisable par le géotechnicien. Par exemple, les sables éoliens sont la plupart du temps peu compacts, à granulometrie très serrée et à base de grains « ronds-mats ». Ou bien, pour les problèmes de tassement il est intéressant de savoir si le sol a été soumis à la surcharge d'un glacier, etc.
Pour en revenir à l'utilité d'une classification géotechnique, nous dirons encore qu'elle fournit un langage à l'aide duquel les connaissances d'une personne sur les caractéristiques générales d'un sol donné peuvent être transmises à d'autres personnes d'une manière claire et concise, — donc sans avoir à entrer dans de longues descriptions et analyses détaillées.
Enfin, la classification est encore un instrument de travail qui permet de regrouper méthodiquement les très nombreux échantillons d'une campagne de sondage en vue d'établir les coupes géotechniques du terrain. C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'utilisateur devra faire preuve dans sa synthèse « d'intelligence dans son application servile» du système de classification — en ayant par exemple présent à la mémoire la dispersion des résultats de nos essais classiques de laboratoire (tamisage et limites d'Atterberg).
QUELS SONT LES SYSTEMES DE CLASSIFICATION QUI EXISTENT ?
Ils sont nombreux et il ne peut donc être question de les décrire ici. Indiquons simplement qu'il en existe plusieurs qui sont basés uniquement sur la granularité (en représentation triangulaire par exemple) et plusieurs qui utilisent à la fois la granularité et la plasticité des matériaux. Parmi ces derniers nous avons retenu la classification U.S.C.S. (Unified Soil Classification System) qui nous paraissait la plus satisfaisante.
POURQUOI AVONS-NOUS PREFERE LE SYSTEME U.S.C.S. ?
Pour les quatre raisons suivantes :
1) Son utilisation, après quelques temps de pratique est relativement simple
2) Il est assez complet; en effet, 15 sols types sont retenus, affectés chacun d'un symbole composé de deux lettres.
Par ailleurs, plusieurs combinaisons sont possibles par l'emploi de doubles-symboles: pour classer les sols dans lesquels la granularité autant que la plasticité des éléments fins jouent un rôle, et pour classer les sols n'appartenant pas franchement à l'un des 15 sols types. Le système est donc « souple ».
3) Il est «parlant» car ses symboles sont les abréviations d'une terminologie couramment utilisée par l'ingénieur par exemple Gb = grave bien graduée.
4) Il est adopté par d'autres pays européens, par exemple la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche...
SUR QUELS ELEMENTS GRANULOMETRIQUES ET DE PLASTICITE EST BASE LE SYSTEME DE CLASSIFICATION U.S.C.S. ?
Ce système dû au Professeur A. Casagrande, est basé uniquement sur des caractéristiques granulométriques pour les sols contenant un pourcentage de fines suffisamment faible pour ne pas affecter le comportement géotechnique du matériau. Il est basé uniquement sur des caractéristiques de plasticité pour les sols dans lesquels les fines jouent un rôle prépondérant. Le recours simultané aux caractéristiques granulométriques et de plasticité se fera pour les sols compris entre ces deux catégories.
Les caractéristiques granulométriques retenues sont :
- les pourcentages de graviers, de sable et de fines ;
- la forme de la courbe granulométrique.
Les caractéristiques de plasticité retenues sont :
- la limite de liquidité et
- l'indice de plasticité.
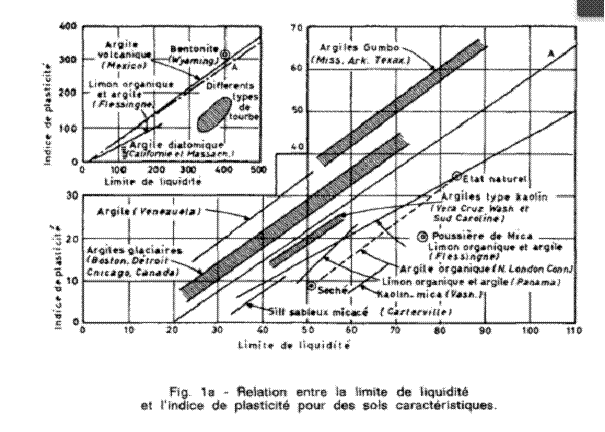
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
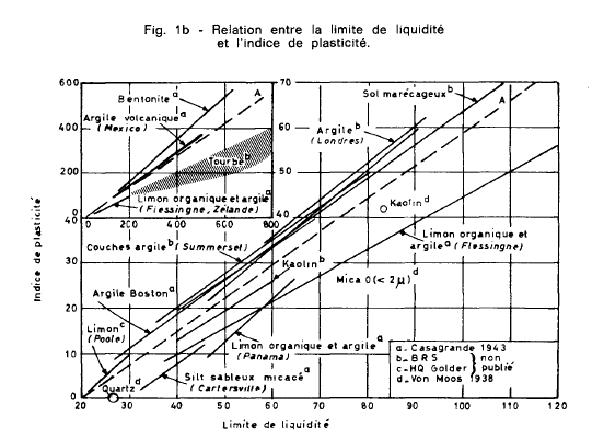
Eléments granulométriques
Quelles sont les dimensions correspondant aux graviers, sables et fines ?
Les classes granulométriques utilisées actuellement en France sont celles définies par Atterberg en 1905. Les «diamètres» d des particules sont les suivants :
|
Cailloux |
d > 20 mm |
|
Graviers mm |
2mm< d < 20 mm |
|
Gros sable |
0,2 mm < d < 2 mm |
|
Sable fin |
0,02 mm < d < 0,2 mm |
|
Limon |
0,002 mm < d < 0,02 mm |
|
Argile |
d < 0,002 mm |
Ces classes granulométriques, dont les seuils sont fixés arbitrairement, diffèrent sensiblement d'un pays à un autre et même — dans un pays — d'un organisme à un autre (Tableau 2). En particulier, les seuils retenus dans la classification U.S.C.S. d'origine ne correspondent pas aux seuils utilisés en France puisque cette classification U.S.C.S. porte sur :
|
Graviers |
d > 4,76 mm |
|
Sable |
0,074 mm < d < 4,76 mm |
|
Fines (limon et argile) |
d < 0,074 mm |
Le Tableau 2 explique pourquoi nous avons remplacé dans la classification U.S.C.S. d'origine 4,76 mm par 2 mm pour le seuil entre gravier et sable ; en effet ce seuil de 2 mm est adopté par de nombreux pays.
La dimension 0,074 mm a été remplacée par le tamis français le plus voisin, c'est-à-dire 0,08 mm.
La classification U.S.C.S. ne fait pas la différence du point du vue granulométrique — entre limon et argile. Cette différenciation se fera à l'aide des limites d'Atterberg. Signalons simplement, en passant, que le seuil de 0,002 mm étant fréquemment retenu par divers pays, il n'y a pas lieu d'envisager sa modification et nous sommes alors amenés à considérer que la classe granulométrique des limons serait telle que 0,002 mm < d < 0,08 mm
En se reportant encore au tableau 2, nous constatons d'ailleurs que, pratiquement, seules les divisions retenues en France fixent la limite supérieure des limons à 0,02 mm. Les autres pays hésitent entre 0,05 et 0,06 mm et on comprend dès lors que les auteurs américains aient décidé de fixer à 0,074 mm (0,08 mm) le seuil entre sable et «fines», cette dimension correspondant au tamis le plus fin couramment utilisé.
En conclusion donc, du point de vue granulométrique, la classification utilisera :
1) le pourcentage de tamisât à 0,08 mm ;
2) le pourcentage de tamisât à 2 mm -; et en plus
3) deux coefficients permettant d'apprécier la forme de la courbe granulométrique et calculés à partir de cette dernière :
- le coefficient d'uniformité
- le coefficient de courbure 2 (ou de Hazen)
D10, D30 et D60 représentent les diamètres des grains à 10, 30 et 60 % de tamisat (4).
Eléments de plasticité
Comment sont utilisées les limites d'Atterberg pour classer les sols plastiques ?
Ces sols sont classés à l'aide d'un diagramme de plasticité établi en portant en ordonnées l'indice de plasticité et en abscisses la limite de liquidité.
En reportant ainsi de très nombreux résultats de limites d'Atterberg, Casagrande a obtenu la figure 1 a, la figure 1 b ayant été obtenue par Cooling, Skempton et Glossop (5) sur des sols britanniques.
On remarque sur ces figures que :
1) d'une manière générale les argiles se situent au-dessus d'une droite « A » d'équation :
|
l p = 0,73 (WL — 20). |
Font exception les argiles du type «Kaolin» peu plastiques, qui entrent souvent dans la composition des limons ;
2) les sols contenant des matières organiques se situent au-dessous de la droite « A ».
C'est en se basant sur les graphiques de la figure 1 que Casagrande a établi le diagramme de plasticité de la figure 2 qui sera utilisé pour classer les sols plastiques.
REMARQUE IMPORTANTE : Les graphiques de la figure 1 sont obtenus en réalisant les limites d'Atterberg sur matériaux n'ayant pas subi de séchage à l'étuve à 105°C. Il ne faut pas oublier qu'on a malheureusement pris l'habitude d'exécuter les limites d'Atterberg sur des matériaux ayant séché plusieurs heures dans une étuve à 105°C. Ce séchage influençant sensiblement les résultats finales.
Mode Opératoire du Laboratoire Central (L.C. P.C.) demande de l'éviter.
LA CLASSIFICATION PROPREMENT DITE, SON UTILISATION
La classification L.P.C. * utilise soit les résultats classiques d'essais de laboratoire (tamisage, limites d'Atterberg), soit l'appréciation visuelle et des tests simples sur le chantier. Disons tout de suite qu'il faut une grande expérience pour employer correctement la méthode rapide ou méthode de chantier.
Les symboles utilisés sont les suivants :
a) Eléments du sol
G = Grave, le gravier est la fraction principale
S = Sable, le sable est la fraction principale
L = Limon ou limoneux
A = Argile ou argileux
T = Tourbe
O = Organique, le sol contient des matières organiques.
b) Granulométrie du sol
b = bien gradué, toutes les dimensions de grains sont représentées — aucune ne prédomine
m = mal gradué — une (ou plusieurs) dimension(s) de grains prédomine(nt).
c) Plasticité du sol
t = très plastique (limite de liquidité élevée)
p = peu plastique (limite de liquidité faible).
Cette méthode prévoit trois étapes pour classer un sol :
1) détermination des caractéristiques fondamentales du sol qui se fera par la granulométrie et par la détermination de l'influence de l'eau sur les caractéristiques des grains très fins.
2) classification du sol, qui obtient une dénomination type et un symbole de groupe ;
3) description du sol, nécessaire pour différencier éventuellement deux sols classés dans le même groupe.
Détermination des caractéristiques fondamentales
— La composition granulométrique : en laboratoire, la courbe granulométrique est établie par tamisage, alors que sur chantier (ou méthode rapide) on se contente de l'appréciation des tamisats à 0,08 mm et à 2 mm.
— La plasticité : elle est déterminée en laboratoire par les limites d'Atterberg ; l'appréciation sur chantier (ou méthode rapide) se fera par les essais d'agitation, de consistance et de résistance à sec.
— La teneur en matières organiques : elle est mesurée en laboratoire ; sur chantier, elle est appréciée par la couleur (foncée), l'odeur, l'aspect spongieux, la texture fibreuse.
Classification du sol (tableau 1)
Subdivision préliminaire
Une première subdivision, d'après la proportion des grains inférieurs et supérieurs à
0,08 mm, permet de distinguer :
— les sols grenus : plus de 50 % des éléments > 0,08 mm.
— les sols fins : plus de 50 % des éléments < 0,08 mm.
Classification des sols grenus (tableaux 3 et 4)
Les sols grenus sont eux-mêmes divisés en deux grandes catégories :
— les graves : plus de 50 % des éléments supérieurs à 0,08 mm ont un diamètre
> 2 mm.
— les sables : plus de 50 % des éléments supérieurs à 0,08 mm ont un diamètre
< 2 mm.
Cette division est complétée par la méthode de laboratoire de la façon suivante (tableau 3) :
Moins de 5 % d'éléments inférieurs à 0,08 mm.
Les sols sont alors classés d'après la valeur des deux coefficients suivants : Cu et Cc définis au paragraphe : « Eléments granulométriques ».
(5) American Society of Civil Engineers, March 1948, page 406.
* Etant donné les modifications déjà apportées à la classification U.S.C.S. d'origine, et celles que nous serons amenés à apporter ultérieurement pour mieux l'adapter à nos sols, nous proposons de l'appeler dorénavant classification L.P.C. (Laboratoires des Ponts et Chaussées).